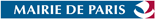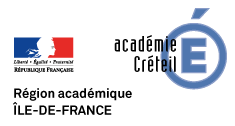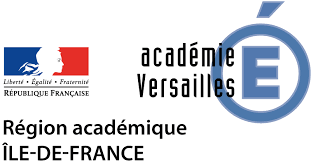Les écrivains / adhérents
Marie-Hélène Lafon
Roman / Nouvelle / Récits
Marie-Hélène Lafon est née dans le Cantal en 1962.
Depuis 1980 elle vit à Paris où elle enseigne les lettres classiques.
Ecrire ça commence comment ?
J’ai attendu longtemps. J’avais trente-quatre ans, c’était à l’automne 1996, et j’ai eu le sentiment de manquer ma vie, de rester à côté ; j’étais comme une vache qui regardait passer le train et les vaches ne montent pas dans les trains. Je me suis assise à ma table et j’ai commencé à écrire « Liturgie », le texte court qui donne son titre à mon deuxième livre publié. Je suis montée dans le train de ma vie, et n’en suis pas redescendue depuis. Non pas qu’écrire soit toute la vie, toute ma vie ; mais je dis volontiers qu’écrire est pour moi l’épicentre du séisme vital ; ou que je ne me sens jamais exister aussi intensément que quand j’écris.
Je dis aussi que j’écris à la lisière, en lisière. C’est d’abord sociologique ; je viens de loin, d’un monde, une famille de paysans du Cantal, où le livre existait peu, où, à l’exception d’une grand-tante restée vieille fille, la tante Jeanne, personne, jusqu’à ma sœur et moi, n’avait fait d’études, où, en d’autres termes, il n’allait pas du tout de soi d’entrer en littérature, d’abord avec les livres lus, ensuite avec ceux que l’on tend à écrire et que, je le constate, on écrit et publie, on étant indéniablement moi. Lire des livres pour étudier, pour avoir un métier, pour devenir par exemple fonctionnaire, professeur, comme ma sœur et moi l’avons fait, est licite, voire encouragé ; un tel parcours, bien que courant dans les années soixante-dix, peut même passer pour un objet de fierté ; mais écrire des livres, c’est une autre affaire, ça sépare, ça échappe. Je suis dans cette échappée, cette séparation du lieu d’origine sociale et culturelle, Par ce fait même, je suis à distance, je reste à distance aussi du milieu d’accueil, dirais-je, celui dans lequel se passe ma vie, ici et maintenant ; c’est l’apanage des transfuges sociaux, d’où qu’ils viennent. C’est ce que j’appelle être à la lisière, entre deux mondes, en tension entre deux pôles, tension féconde et constitutive, je le crois, de l’écriture.
Bibliographie
– Le soir du chien, roman, Buchet Chastel, 2001, en poche Points Seuil 2003.
– Liturgie, nouvelles, Buchet Chastel, 2002.
– Sur la photo, roman, Buchet Chastel, 2003, en poche Points Seuil 2005.
– Ma créature is wonderful, photographies de Bernard Molins, textes de Marie-Hélène Lafon, Filigranes, 2004.
– Mo, roman, Buchet Chastel, 2005.
– Cantal, photographies de Pierre Soissons, textes de Benoît Parret, Fabienne Faurie, Marie-Hélène Lafon, Quelque part sur terre, 2005.
– Organes, nouvelles, Buchet Chastel, 2006.
– La maison Santoire, nouvelle, Bleu Autour, 2007.
– Les derniers Indiens, roman, Buchet Chastel, 2008.
– L’annonce, roman, Buchet Chastel, 2009
– Les derniers Indiens, roman, Folio, 2009
– Gordana, roman vu par Nihâl Martli, éd. du Chemin de Fer, 2012
– Les Pays, roman, Buchet Chastel, 2012
– Album, abécédaire, Buchet Chastel, 2012
– Tensions toniques - les récits de Marie-Hélène Lafon, éd. Archipel, 2012
– Traversée, Créaphis Fondation Facim, 2013
– Joseph, Buchet-Chastel, 2014
– Chantiers, éditions des Busclats, 2015
– Histoires, Buchet-Chastel, 2016 (Prix Goncourt de la nouvelle)
– Les Etés, éd. La Guépine, 2017
– Nos vies, Buchet-Chastel, 2017
– Flaubert, Buchet-Chastel, 2018
– Le pays d'en haut, entretiens, Arthaud 2019
Extraits
Extrait : Les derniers Indiens, roman, Buchet Chastel, 2008.
C’était, au sortir du corps sec de la mère, une litanie qui n’appelait ni commentaire ni réponse, un soliloque définitif, une chronique psalmodiée, un bréviaire absolu. Marie comprenait que ses propres ruminations répondaient à celles de la mère, étaient du même sang, faisaient pendant, muettes, gratuites, incongrues. Sa fantaisie de chaises, de canapé, ou de couteaux neufs n’était pas recevable. Ce qu’elle appelait ses pensées autour de la religion, des prières, des morts, de mai 1968, du corps de l’Alice, de la mère, et du père écrasé par elle, l’étaient encore moins, tout comme d’autres images qui remontaient parfois, précises, crues, en couleurs éternelles ; celle de l’Alice, encore, en 1966, pendant le premier été de la maladie, l’Alice en pleurs, sur le chemin, qui courait, les chairs ballottées, peu vêtue dans la chaleur du plein août, tenant dans ses bras courts, serré contre elle et souillant sa robe jaune à bretelles, un jeune chien mou, les pattes abandonnées, un filet de bave rougie au coin de la gueule, les yeux morts, heurté sur la route par un conducteur surpris que la meute avait assailli au tournant. L’Alice bramait étrangement, la bouche ouverte, rose, le visage enduit de larmes luisantes. La mère avait dit, elle pleure ça connaît pas le vrai malheur, ça pleure pour un chien la vie lui apprendra.
Extrait : Mo, roman, Buchet Chastel, 2005.
Mo consolait les femmes. Elles n’étaient plus jeunes. Elles avaient des maris, et des enfants à élever, plusieurs enfants. Elles se plaignaient, comme la mère. Les aînés des enfants étaient grands, ils n’obéissaient pas, ils échappaient ; ces femmes avaient encore pour elles la peau sucrée des petits. Mo connaissait les enfants, il les croisait dans la cité, il savait qui était qui. Il allait chez ces femmes ; les enfants étaient à l’école et les maris partis, au travail, ou dehors quand ils n’avaient pas de vrai travail. Les maris, souvent, étaient vieux ; ils avaient des habitudes dures. Ils commandaient les femmes qui faisaient tout en cachette. Elles parlaient à Mo, elles lui racontaient, il entendait leurs voix, les histoires glissaient sur lui, il ne se souvenait de rien. C’était sans conséquence. Mo était dans la vie secrète des femmes. On ne le voyait pas, on ne l’apercevait pas, on ne lui prêtait pas attention, on aurait pu dire qu’il allait chez ces femmes pour les menus travaux, comme au centre. Personne ne parlait de Mo. Peut-être les femmes entre elles ; mais il ne le savait pas. Il ne connaissait pas de femmes dans son bâtiment. Il allait ailleurs. Ces femmes étaient pareilles. Leurs corps étaient les mêmes, il le voyait avant de l’avoir fait pour la première fois. Il devinait comment seraient les ventres, les aisselles, les veines des cuisses, et le creux derrière les genoux. Comment seraient les poils, les fesses, et tout ce qui était aux femmes sous leurs vêtements. Il devinait les pieds qu’il tiendrait peut-être dans ses mains si elles étaient d’accord. Il ne regarderait pas les seins. Il les sentirait contre lui, écrasés. Il suivrait du doigt les cicatrices des césariennes qui sont comme d’autres bouches fendues au ventre des femmes et recousues par les mains des hommes. Il reconnaissait avec ses mains les traces du travail des corps et les femmes n’avaient pas de honte. Il les guérissait.
Ma bibliothèque
- Homère, Iliade
- Gustave Flaubert, Madame Bovary / L'éducation sentimentale/ Un coeur simple
- Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit
- Claude Simon, L'herbe / La chevelure de Bérénice
- Pierre Michon, La grande Beune / Vies minuscules
- Laurent Mauvignier, Des hommes
- Julio Llamazares, La pluie jaune
- Mario Rigoni Stern, Histoire de Tönle
- William Faulkner, Sartoris
Lieu de vie
Île-de-France, 75 - Paris
Types d'interventions
- Rencontres et lectures publiques
- Rencontres en milieu universitaire
- Ateliers / rencontres autres publics