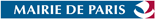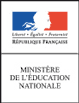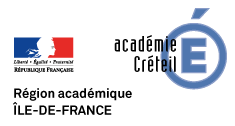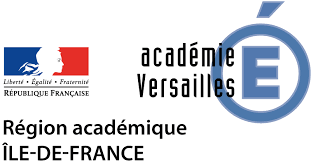Les écrivains / adhérents
Alexandra Destais
Essais
Alexandra Destais est docteure en littérature, professeure de lettres et autrice d’une thèse sur l’érographie féminine, soutenue en 2006 à l’université de Caen Normandie avec les félicitations du jury à l’unanimité. Sa thèse a donné lieu à un essai médiatisé, publié aux Éditions Klincksieck en 2014.
Elle est l’autrice de plusieurs articles publiés dans divers ouvrages, revues et actes de colloque.
Elle est conférencière sur l’Histoire et la littérature des femmes à l’université populaire de Caen depuis 2007. Ses conférences portent essentiellement sur des œuvres littéraires féminines et sur des sujets en lien avec l’Histoire des femmes. Elle a aussi consacré une conférence théâtralisée sur L’Eve Future de Villiers de l’Isle Adam.
Elle est intervenue en 2017 à la Maison de la Recherche de la Sorbonne et à l’université populaire de Caen sur Valentine de Saint-Point. Elle intervient de même aux Franciscaines avec des conférences sur Coco Chanel, La puissance des femmes et Colette en 2024 et 2025. Elle est chercheuse associée à l’université de Caen Normandie et formatrice sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons.
Elle collabore à Ardemment Éditions comme co-autrice de l’ouvrage : Valentine de Saint-Point, l’ardeur et la conquête (publication à venir).
Chaîne YouTube (en cours d’actualisation) :
Bibliographie
- Éros au féminin, éditions Klincksieck, 2014.
- Valentine de Saint-Point, l'ardeur et la conquête, avec Claire Tencin, Ardemment éditions, 2025.
Extraits
- 1er extrait (2014)
Éros au féminin, dernier chapitre "Éloge du trouble" (2014)
Plusieurs siècles d’oppression ont raffiné à loisir les mécanismes du désir et du plaisir chez les femmes. Le désir des femmes a longtemps usé de la métaphore, puisant à de multiples sources afin de se dire, comme en témoigne la poésie féminine du début du XXe siècle ou bien encore les premières œuvres érotiques féminines des années 1950. Seulement voilà. L’érotisme a perdu ses lettres de noblesse au profit de la transparence pornographique, du culte de l’organique direct qui dépoétise, appauvrit et déshumanise le rapport aux choses de l’amour. Les femmes, qui ont intériorisé le modèle traditionnel de la bonne mère et de l’épouse parfaite, se doivent dorénavant d’être également performantes au lit à l’image des actrices du X qu’aucune pratique ne rebute, d’être offensives au travail et de poursuivre en prime une réalisation personnelle à laquelle les autres injonctions font inévitablement barrage. Impossible idéal du moi à concrétiser qui supposerait de lâcher un peu de lest afin de favoriser l’ascension…
Françoise d’Eaubonne, l’auteure du Complexe de Diane, n’avait peut-être pas tort lorsqu’elle conjurait les femmes à ne pas vouloir tout maîtriser et à s’abandonner, sans pour autant se perdre, dans l’intimité car telle était la condition de leur jouissance. Lâcher du lest, c’est ne pas se sentir obligée d’accepter la demande libertine du conjoint pour afficher sa prétendue liberté de mœurs, ne pas se refuser du temps personnel et, au sein de ce temps personnel, de céder parfois à l’appel délicieux, gratuit, noble, du trouble amoureux. Le trouble est une occasion d’enchantement. Il est un appel discret au plaisir des sens, une volupté du creux du ventre et une joie de l’esprit qui ne requièrent pas un dépassement insensé des limites, un passage obligé à l’acte physique et une brisure conjugale. Il a la tiédeur d’un souffle printanier qui caresse la joue sans la brûler, qui frôle la jupe sans la soulever, qui pose sur les lèvres comme un suave baiser. Le trouble interrompt le geste ordinaire et démasque l’être intime, révélant la vérité amoureuse d’une attraction qui se passe volontiers des mots. Ce trouble ne peut naître qu’à la faveur de cette disponibilité intérieure minée de nos jours par la réactivité permanente, l’obligation de résultats, le sentiment permanent de l’urgence. Il suffit pourtant de peu de choses, d’un peu d’attention, de lever la tête dans la rue que l’on traverse, de ne pas fixer le bout de ses escarpins comme une monomaniaque tendue vers l’objectif mais de regarder autour de soi, de respirer, de débusquer des occasions de beauté là où celles-ci se nichent. Le trouble amoureux fait vaciller l’être intime qui est en nous, réveille ce bon petit diable censuré par la morale ambiante, crée un léger étourdissement face à cet autre, homme ou femme, qui attrape notre regard et atteint le creux de notre corps. Il est une brèche dans notre appréhension rationnelle des choses, un doux délire des sens.
- 2e extrait
Valentine de Saint-Point, L'ardeur et la conquête (Ardemment Éditions, 2025) - Co-autrice de l'ouvrage avec Claire Tencin
Le Manifeste de la femme futuriste (1912) puis Le Manifeste de la Luxure (1913)
Âge d’or des manifestes littéraires, la « Belle Époque » en a vu fleurir plus de quarante parmi lesquels on peut citer : le manifeste décadent d’Anatole Baju (1886), « Aux lecteurs ! », le manifeste socialiste du même Baju « La littérature de demain » (1891), « le manifeste du futurisme » de Marinetti (1909), le « manifeste symboliste » de Jean Royère (1909), « l’art cérébriste » de Ricciotto Canudo (1914), le compagnon de Valentine. Le manifeste est principalement un outil contestataire, fondé sur un principe de rupture, d’affirmation péremptoire d’une vérité, d’une volonté totale de dénoncer pour refonder et non pas seulement de déconstruire... Il ne s’agit pas d’une voie d’écriture pacifique. L’histoire du mot montre qu’il a partie liée dès son origine avec l’idée d’une dénonciation publique, d’une insurrection, d’une prise de parole révolutionnaire ou réactionnaire. Ce genre a son humeur : il est un genre bilieux, naissant notamment d’un mécontentement violent à l’égard de l’Institution qu’il cherche à secouer avec insolence. Lorsqu’on évoque le manifeste, on songe le plus souvent spontanément au « manifeste du surréalisme » d’André Breton (1924) ou bien encore à Tzara, père du dadaïsme, qui dénonce en 1920 « la syphilis politique, astronomique, artistique, parlementaire, agronomique et littéraire ». C’est oublier un autre mouvement qui les a précédés : le futurisme.
C’est en 1909 qu’éclot en Italie ce mouvement collectif organisé autour d’un chef charismatique, Marinetti, et d’un programme commun qui est précisé non seulement dans des manifestes mais aussi dans une revue qui accompagne l’éclosion du mouvement : Poesia. Traditionnellement, la publication en 1909 du Manifeste de fondation du futurisme constitue l’acte officiel de naissance de ce mouvement tandis que l’année 1924 est souvent avancée pour signaler la fin du futurisme. 5 ans avant une guerre qui, comme on le sait, sera dévastatrice, le mouvement résume son projet en ces termes belliqueux :
« Glorifier la guerre – seule hygiène du monde – le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, et le mépris de la femme »
De même qu’Olympe de Gouges qui réagit à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par une riposte en 1791 avec sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Valentine utilise le même vecteur littéraire que son « adversaire » pour dénoncer ce qui lui déplaît et défendre sa propre conception. C’est contre « le mépris de la femme » qu’elle s’insurge, ne reconnaissant pas son propre tempérament de feu dans l’image dégradante d’un féminin infériorisé, dévitalisé que donne à voir Marinetti. C’est à ce sentiment d’arrogance supérieure qu’elle réagit. Ses textes constituent le geste inédit d’une écrivaine qui est la seule femme à signer des manifestes et qui est la seule, en 1914, à faire partie de l’organigramme du mouvement en tant que « responsable de l’action féminine ». Avec ses manifestes, elle affirme son indépendance intellectuelle : elle n’est pas la disciple soumise d’un chef charismatique mais son égale. Elle charge et se charge de remettre en cause ou bien de préciser ce que les futuristes sont incapables de faire à l’intérieur de leur groupe, soit ce consensus masculin autour d’une vision amoindrie de la femme : inexistante, coquette, tourmentée par ses nerfs, porteuse de peines et de déconvenues, femelle sentimentale aspirant à la stabilité du lien matrimonial, etc. Le choix du manifeste lui permet de faire passer des idées puissantes et d’incarner son discours dans une lecture publique, de mettre en chair sa pensée complexe. Avec ce vecteur, elle transgresse les limitations génériques et s’approprie donc un outil masculin. Ce n’est pas l’attaque de Marinetti contre le féminisme qui suscite la riposte de la futuriste puisque sur ce plan, elle partage globalement ses vues mais bien le trait de misogynie qui infériorise la femme. Aussi, au fameux mépris qui est restée comme la lettre écarlate du mouvement futuriste, Valentine substitue la prise en compte de celle-ci :
« Voilà pourquoi, au lieu de la mépriser, il faut s’adresser à elle. C’est la plus féconde conquête qu’on puisse faire ».
Ma bibliothèque
Abbé Prévost, Choderlos de Laclos, Balzac, George Sand, Maupassant, Valentine de Saint-Point, Colette, Victor Margueritte, Anaïs Nin, George Orwell, Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Françoise Sagan, Benoîte Groult, Régine Deforges, Jean-Philippe Toussaint, Leïla Sebbar, Annie Ernaux, Leïla Slimani, etc.
Lieu de vie
Normandie, 14 - Calvados
Types d'interventions
- Ateliers d'écriture en milieu scolaire
- Rencontres et lectures publiques
- Ateliers d'écriture en milieu universitaire
- Rencontres en milieu universitaire
- Ateliers / rencontres autres publics
- Résidences
- Rencontres en milieu scolaire