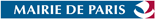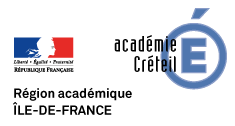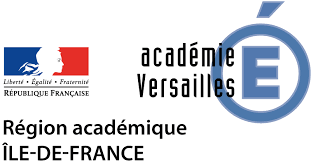Expression libre
Textes
ajouté le 07|02|17
La lecture insistante
L’écrivain et traducteur Vincent Broqua répond aux questions posées par Sylvie Gouttebaron, directrice de la Mel
Si nous parlons "d'insistance", pour la lecture (terme que j'emprunte à Heinz Wismann, développé avec Jean Bollack), qu'est-ce que cela évoque pour toi (prenons "toi", d'abord en tant que traducteur).
Je commence par insister sur la lecture publique. En ce moment, mon travail de recherche universitaire et de création (les deux entretiennent des rapports étroitement sexués) est consacré en grande partie à une série de questions : comment la traduction se lit-elle en public ? que se passe-t-il lorsqu’une traduction est dite en public ? (comme cela affecte-t-il le texte de départ, dans l’autre langue ? / comment cela affecte-t-il le poète de l’autre langue ?) Qu’est-ce que le corps du traducteur ? Comment traduit-on la performance et comment performe-t-on la traduction ? – lire la traduction en public est une façon de jouer la traduction, de la risquer, de se risquer à la dire, de risquer son corps, lui qui ne demandait pas à être vu et entendu – on s’aperçoit parfois qu’une traduction s’effondre complètement au moment de la performer (pour reprendre ce terme désormais courant en français). On est là, on lit, et tout est dépeuplé [froncement des sourcils]. Comme dit une amie : « ach ! ». Ces questions qui me passionnent parce qu’elles disent un état actuel de la poésie et du texte au contact de la traduction, est mon insistance : insistance du traducteur à traduire, insistance du traducteur à être un complice (parfois réticent ou malgré lui) de la « performance » ; même si la lecture de la traduction est parfois détimbrée, elle est toujours particulièrement vive. Elle crée un objet insistant – je me souviens, par exemple, d’une lecture pendant laquelle Juliette Valéry traduisait le bouillonnant Charles Bernstein, leur style de lecture ne pouvait être plus différent et, pourtant, l’objet créé était d’une rare intensité. (On peut écouter et voir cette lecture dans le coffret #1 de DVD de Double Change publié par Abigail Lang et Dominique Pasqualini aux Presses du Réel).
On dira, l’insistance, ce n’est pas la vie – on dira, l’insistance, c’est, comme d’autres l’on dit, creuser, miner la langue, comme on dit : se faire une langue étrangère dans la langue qu’on a apprise mais qui reste inadéquate (comme il dit : « les plus beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère »). On dira, aussi, l’insistance c’est la traduction même (on lira ceci : « féconder le propre par l’étranger »). On dira, l’insistance, c’est une forme d’écriture qui joue et déjoue la répétition : Gertrude Stein à propos de son écriture prétendument répétitive parle de la répétition comme d’une insistance – la répétition alors, n’est pas un passage à vide de la langue, mais des variations qui sont une tentative de sonder la vie dans ses mécanismes les plus fins. Entendez un oiseau chanter, vous aurez l’impression qu’il chante toujours pareil, écoutez un oiseau chanter, son chant est fait de variations, il insiste, il est la vie. On dira ceci simplement, même si la question de savoir ce qu’est la vie n’est pas évidente. Dit-on.
Alors, « l’insistance » ? Retour à ta question : tu évoques Heinz Wismann, ses travaux – un déplacement, les langues en contact, les passages entre les langues, ce qui est tellement important dans l’écriture et la traduction, car il m’est assez difficile de séparer les deux. L’insistance, c’est le lien indéfectible qu’il y a entre traduction et écriture dans des rapports non linéaire, des passages : pas de philologie, pas de cheminement, des trajectoires. « Sous huitaine je vous en dirai mon jugement définitif, sauf à me rétracter lorsqu’un plus intelligent que moi me démontrera que je me suis trompé. » (J le F)
Que cherches-tu à donner à entendre d'un texte que tu as choisi de traduire (comment procèdes-tu pour l'interpréter ?)
« L’Editeur ajoute : la huitaine est passée ». Ce que je cherche à donner à entendre ? Je ne sais pas, cela varie d’un texte à l’autre – aucune théorie de la traduction quand je traduis, ou alors une théorie de la traduction qui s’élabore en traduisant – Avec David Antin, certainement, privilégier la langue parlée, quoique soutenue souvent ; avec Anne Waldman, chercher l’oralité, le grand air, la grande santé de la voix (celle qui dit à l’oral et non pas la notion abstraite de voix, en laquelle je ne crois pas) ; pour Claude Rutault, chercher la rigueur de la formulation mais aussi la spécificité très française de son écriture ; et ainsi de suite, mais il n’y a pas de règle –
Comment le lis-tu ? Passes-tu par une lecture "voix haute" ? Comment s'inscrit-il en intelligence dans ton esprit ? Puis dans ta langue ?
Oui, toujours une lecture à voix haute, pour moi-même, parfois contradictoire de celle de l’auteur, car la lecture de l’auteur est une actualisation des possibilités multiples d’un texte – mais aussi toujours lecture sur la page, l’inscription sur la page est crucial – son rapport double, au moins : oral / page ; la façon dont il insiste à être les deux à la fois – est d’une importance capitale. Je ne sais pas s’il s’inscrit dans mon esprit, c’est plutôt dans mon corps qu’il s’inscrit – il y a des moments d’impossibilité de traduction tout simplement parce que le corps ne répond pas du tout, il est bloqué – je dirais que les traductions qui m’intéressent sont des langues à construire dans des passages incessants d’une langue à l’autre, il n’y a pas d’inscription définitive, ni pour le soi-disant « original » ni pour la traduction – elle n’est peut-être jamais aboutie, même si elle est publiée / de la même manière qu’un texte n’est qu’une actualisation de potentialités multiples – c’est peut-être pour cela qu’on poursuit l’écriture ou qu’elle nous court après – et qu’on poursuit la traduction, pour échapper à la philologie (bis), voire pour échapper tout court. Il n’y a donc pas de processus unique, mais des retours, des allées, des vitesses, des reculades, des virages, des ratures, des réécritures, des doutes, de l’affirmation, et non un chemin de la langue de l’un vers la langue de l’autre – une contamination croisée a lieu – des langues dans les langues. Une Babel heureuse, pour reprendre le titre d’un livre fabuleux d’Arno Renken.
Le fait d'écrire toi-même (j'interroge ici l'auteur, le poète si tu en acceptes le terme), modifie-t-il ta manière de lire ? Comment te projettes-tu ? Que restera-t-il de cette projection dans la traduction ?
Auteur ou pas, la manière de lire est toujours affectée par notre rapport à l’écriture (on en a toujours un, voire plusieurs, discordants) – mais j’imagine que pour moi les textes choisis, les langues traduites (et intraduites), les auteurs, les formes, sont fonction de l’écriture en cours et à venir – soit parce que je renifle le texte de l’autre, je m’y glisse et le fait se déplacer, je tire la couverture à moi, je le récupère (pour utiliser à nouveau ce mot), je me livre à des opérations peu reluisantes – mais aussi parfois, souvent, parce qu’un auteur que je n’attendais pas me surprend totalement, me fait me réinventer ma langue, ou une partie d’elle – à l’inverse, je me surprends à écrire ces traductions, à trouver dans la traduction une partie de mon travail poétique – pour diverses raisons (rires, humeur, amitié, désamour, analyse, étude, …) tout cela flotte et c’est ce qui est important, il me semble, de garder les yeux et les oreilles ouvertes, laisser filer, être poussé à se réinventer totalement ou partiellement en traduction, à sortir de tout cela par le haut (ou par le bas), à en sortir même si on y est toujours – [rires].
Les textes lus te reviennent aussi en ritournelles, emprunts dont tu fais ton miel dans ton travail. La lecture semble donc à maints égards, pour toi, une invention ? Es-tu d'accord ?
Ça oui ! ça oui ! c’est la hantise [rires] – mais c’est un phénomène plus général, on est sujet à stratifications et sans vouloir parler pour mon prochain, je crois que c’est sensiblement la même chose pour nous toutes : la lecture reste – elle revient, elle perce à des moments inattendus – c’est la même chose lorsque j’enseigne, lorsque j’écoute de la musique, lorsque je vais à une lecture particulièrement frappante – tout reste là et parfois ressurgit, ça insiste et ça insiste parfois ça insiste tant que ça devient délicat : on s’excite, on taquine, à force d’en parler on finit même par agacer les amis, les amants, les connaissances, les étudiants avec ça, c’est presque amusant de voir les réactions – imaginons : je suis là dans un lit, ou sur le parquet, ou n’importe où, là avec mon compagnon (forcément compréhensif) : « attends, faut que je te dise un truc : ‘nor marble, nor the gilded monuments of princes’ » – longtemps je me suis pris une phrase (des sortes de vers) de Rosmarie Waldrop qui réapparaissait comme une véritable ritournelle, j’amorçais un virage sur l’autoroute et, toc !, elle était là, paf !, elle surgissait d’une poubelle, d’un trottoir, de la Seine, devant un gratte-ciel (Trump Tower ou Dump Tower), en plein milieu d’une conversation : « On a balcony onto the Seekonk stands. And full of thoughts of winter . My friend . And drunk with red wine I » – une véritable intoxication, le texte y pousse, j’en ai d’ailleurs parlé à l’intéressée – il fallait dire ces vers, soit en les intégrant dans la conversation [jeu] soit en la disant sans se préoccuper de l’étiquette versaillaise de certains milieux protocolaires – en même temps, bien entendu, elles peuvent revenir, ces phrases / ces vers, de manière totalement modifiées, déjà traduit(e)s – troublées par la traduction, par l’écoute, par la mémoire – La lecture est une invention et une non-invention, elle peut être totalement niaise, faible, sans relief, un simple recopiage. Un simple recopiage est souvent beau comme un dieu. Il pourrait être une non-invention, une non-création, voire une simple opération de transfert, terme à terme (même si, dans ces transferts, il s’en glisse des choses) ; mais je dirais que la lecture, les lectures sont des collisions, des flirts, ou parfois de puritains états de verbatim –
Distingues-tu une lecture d'un auteur classique de celle d'un auteur contemporain ? Et si oui, comment définis-tu cette différence (références...) ?
Question difficile tant je n’aime pas beaucoup la notion de classique – à la fois parce qu’elle enferme tel ou tel auteur dans son statut passé, monumental et marmoréen – je ne dirais pas qu’il n’y a pas de différence entre des auteurs majeurs des siècles passés et des auteurs présents – mais je n’arrive pas à dire les uns ou les autres par un couple chien = classique/ chat = contemporain. Je résiste à cette idée – dans mon livre en cours, il y a tout à la fois / dans mon livre précédent aussi / Anne Portugal cotoie « tout le monde » cotoie Ovide cotoie Godard cotoie Genet cotoie Robert Creely cotoie Virginie Despentes cotoie Avital Ronell cotoie Caroline Bergvall cotoie Stacy Doris cotoie Pasolini cotoie Racine cotoie Denis Roche cotoie Pascal Poyet cotoie Homère cotoie Angela Davis cotoie co-toi / tous se rencontrent, s’aiment et ne s’aiment pas, se détestent parfois, se ferment la porte au nez [clac !], mais ils traversent les textes sans forcément faire référence – sur mon bureau, je pourrais faire la liste des livres et des piles, elles sont bien hétérogènes – tout s’entasse de la même manière : de Sappho à Warhol, en passant par NourbeSe Phillips ou Nathalie Quintane (Que faire des classes moyennes ?, acheté vendredi 2 décembre 2016 à Lausanne, lu le 2 décembre 2016 dans le train Lausanne-Paris)… il doit y avoir Bruce Nauman aussi qui traîne et rôde, jamais loin, Christian Marclay ou Matisse et Merce Cunningham font la conversation, Chaplin passe aussi la tête par la porte : « voulez-vous la taxi-meter » / j’entasse, j’emplie, je jongle, je lis, je ne lis pas, je flâne, je m’échappe, je fuis – l’une des dernières phrases de mon précédent livre : Montaigne : je m’instruis mieux par fuite que par suite / à lire avant Diderot « Toujours de la gaieté et de l’imagination », la première phrase de mon livre en cours d’écriture – parfois cela fait sens, parfois non, c’est ainsi, je ne m’en offusque pas – il y a des rencontres qui ne se décident pas et d’autres qui sont un travail. Romeo : O she doth teach the stars to burn bright !
Y a-t-il une profondeur à la lecture ? Un fond ? Ou bien est-ce sans mesure, un infini à peupler ?
Sans mesure pour mesure – comme le dit le jeune personnage de Woody Allen : the universe is expanding. Mais je m’en voudrais de vouloir peupler l’infini, quand même, et même si on le souhaitait, qui pourrait, même collectivement, y parvenir ?