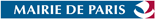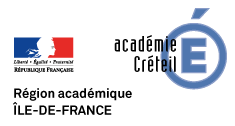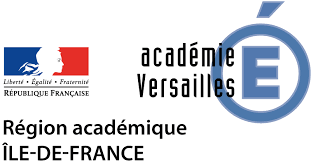Les écrivains / adhérents
Sonia Hanihina
Roman / Théâtre
Sonia Hanihina, romancière et dramaturge, vit à Paris. Agrégée de lettres, elle a longtemps enseigné la littérature et l’histoire de l’art, avant d’interrompre sa carrière pour s’autoriser.
Le nom tunisien qu’elle porte signifie « Je suis là ». Elle se plaît pourtant à dire qu’elle ne l’a pas toujours été. Ventriloque pendant trente ans, elle a enseigné les mots des autres, célébré les grandes voix de la littérature française, disséqué les alexandrins et les vers impairs « plus soluble[s] dans l’air », débusqué les anacoluthes, zeugmas et autres hypozeuxes.
Elle a avalé sa langue, effacé son corps, égaré dans l’étude et la lecture son encombrant héritage. Née d’un homme qui inonda le sol du sang de son épouse et ses veines de palfium avant de s’évanouir et d’une femme qui détruisit les photos, toutes, dansa sur une tombe vide, y glissa puis se mura dans le silence, elle a découvert un jour des clichés radiographiques. Ce fut comme une révélation. Devenues cartes à explorer, territoires à parcourir, ces images de corps brisé ont fertilisé sa mémoire. Interrogeant les ombres, explorant les catacombes, les ossements se sont empilés en un improbable édifice : son premier roman. Le Tube de Coolidge, Label « La Grenade » des Éditions JC LATTÈS.
Sonia Hanihina sonde les « territoires du silence », interroge la mémoire individuelle et collective. Ses écrits explorent et documentent l’histoire de familles immigrées, exilées. Voyages entre les deux rives de la Méditerranée, ses textes « babéliens » mêlent le français, l’arabe et le berbère en une langue poétique d’une brutale intensité, la violence de la langue faisant écho à la violence de l’Histoire.
Bibliographie
- Le Tube de Coolidge, JC LATTÈS, 2024
Extraits
Extrait 1
Je tiens, scellé dans un coffre, le corps en pièces de ma mère. Dissimulés sous une pile de vêtements colorés, à l’abri des regards, du mien surtout, dans un grand sac en papier fort d’une enseigne de luxe, des clichés radiographiques sommeillent. Le corps souffrant ne s’exhibe pas. Dans une fébrilité inquiète, je guette leur message opaque. Ces intérieurs, amas blancs et noirs, affichés sur le négatoscope ne s’offrent qu’à l’expert. Il me plaît pourtant de heurter aux silences ce projet impudique. Dans mon armoire et dans mon cœur, ces radios attendent que je leur donne la parole.
J’ai longtemps cru que je n’avais rien à dire. Je n’avais pas de souvenirs d’enfance. Comment faire surgir les images quand on a grandi derrière des cloisons à redouter des cris et des soupirs ? Et puis, je suis tombée sur ces radios. Ce fut comme une révélation. Devenues cartes à explorer, territoires à parcourir, ces pellicules rectangulaires ont fertilisé ma mémoire. J’ai interrogé leurs ombres et ravivé, par fragments, les souvenirs de douleurs tues. En les découvrant, gondolées comme sous l’effet du soleil, les mots ont cillé. Mes textes fragmentaires sont devenus tableaux, tentatives pour faire surgir du néant des hommes et des lieux, la terre dont je viens, Tunisie longtemps fuie dont je refusais l’héritage.
Ce livre est mon album de jeunesse, ma discothèque, mon reliquaire.
Extrait 2
Décembre 1967
Les trottoirs de Paris sont couverts d’une fine pellicule de glace. Elle ralentit les démarches de ceux qui, d’ordinaire, se hâtent. Aujourd’hui, les voitures, les autobus et les vélos se font rares. Vos deux élégantes silhouettes glissent dans cet hiver que tu ne connais pas encore. Dans ton pays, la pluie froide de février irrigue les sols mais jamais le mercure ne paresse en dessous de zéro. À peine le gharbi, ce vent qui soulève le sable, se fait-il menaçant. Les yeux des hommes se plissent et les corps se couvrent de longs burnous. Les maisons retiennent les femmes à l’intérieur. Les sols et les portes disparaissent sous les lourds tapis. Les patios ne résonnent plus des éclats de voix et des rires des familles. Même l’eau des fontaines se tait. On murmure, les mois d’hiver. On s’affaire en silence à emplir les celliers que l’on rouvrira quand vibreront, une fois l’été revenu, les chants des mariés ou des circoncis.Tu penses à la Tunisie ensommeillée. Tes doigts engourdis te font mal. Tu avances mal chaussé sur le pont Saint-Michel. Tu as remonté le col du pardessus trop fin qui te tient lieu de manteau. Tu glisses sur le trottoir, la main de Jeanne dans la tienne, des arabesques dessinées sous vos pas. Le sang reflue peu à peu. Ton corps s’éveille et c’est douloureux. Dans tous les regards que tu croises, ton visage gris reste celui d’un Arabe. Une menace. La guerre n’est pas loin. Le froid devient vertige. Tu t’accroches au parapet. À tes tempes battent les cris de tes frères algériens. Il te semble les entendre basculer dans l’eau froide. Tu n’as pourtant pas vu plonger dans la Seine ceux-là dont la main armée de Maurice Papon a noyé les colères.
Dans les nuits d’octobre 1961, Paris n’était pour toi qu’un rêve. Tu lisais Baudelaire et rêvais tuyaux, clochers et mâts de la cité. Tu ne savais rien de tous ces Algériens, hommes, femmes, enfants sortis de leurs usines ou des appartements de banlieue pour marcher dans les parcs interdits, braver le couvre-feu, sourires et robes colorées en réponse aux violences. La main de Jeanne dans ton dos t’agrippe pour empêcher ta chute.
Pour un coup porté par le FLN, on en rendra dix. Le préfet de Paris durcit sa lutte contre le terrorisme. Tu crois entendre les déflagrations. Les balles mortelles fauchent la foule pacifique. De jeunes corps s’affaissent. La pression dans ton dos est maintenant celle d’une main ennemie. Tu ne reconnais plus le visage de Jeanne. Elle non plus ne reconnaît pas ce rictus à tes lèvres. Tu retrouves l’équilibre. À peine. Redressé sur le pont Saint- Michel, une glissade et tu heurtes un passant. Un mauvais mot lui échappe. Tu voudrais plonger l’homme dans l’eau froide. Jeanne t’en empêche. Silencieux, vous filez vers la fac. Place Saint-André-des-Arts. Tu as desserré le poing. Le sang afflue désormais dans tes doigts ravivés. Un baiser furtif. Jeanne attendra la fin de ton cours dans un café où se réchauffer. Tu entres dans l’amphi.
Yacine, deux syllabes sur les lèvres de toutes les étudiantes. Il te plaît de leur plaire. Tu sors de son étui de cuir le stylo Waterman que t’a offert ta belle-mère. Il glisse sur la page où tu dessines à grands traits un cœur en coupe verticale. Dans le tien, sourd un violent concert.
Ma bibliothèque
Charles BAUDELAIRE, Georges PEREC
Marie NDIAYE, Mathias ENARD, Antoine WAUTERS
Lieu de vie
Île-de-France, 75 - Paris
Types d'interventions
- Ateliers d'écriture en milieu scolaire
- Rencontres et lectures publiques
- Ateliers d'écriture en milieu universitaire
- Rencontres en milieu universitaire
- Ateliers / rencontres autres publics
- Résidences
- Rencontres en milieu scolaire